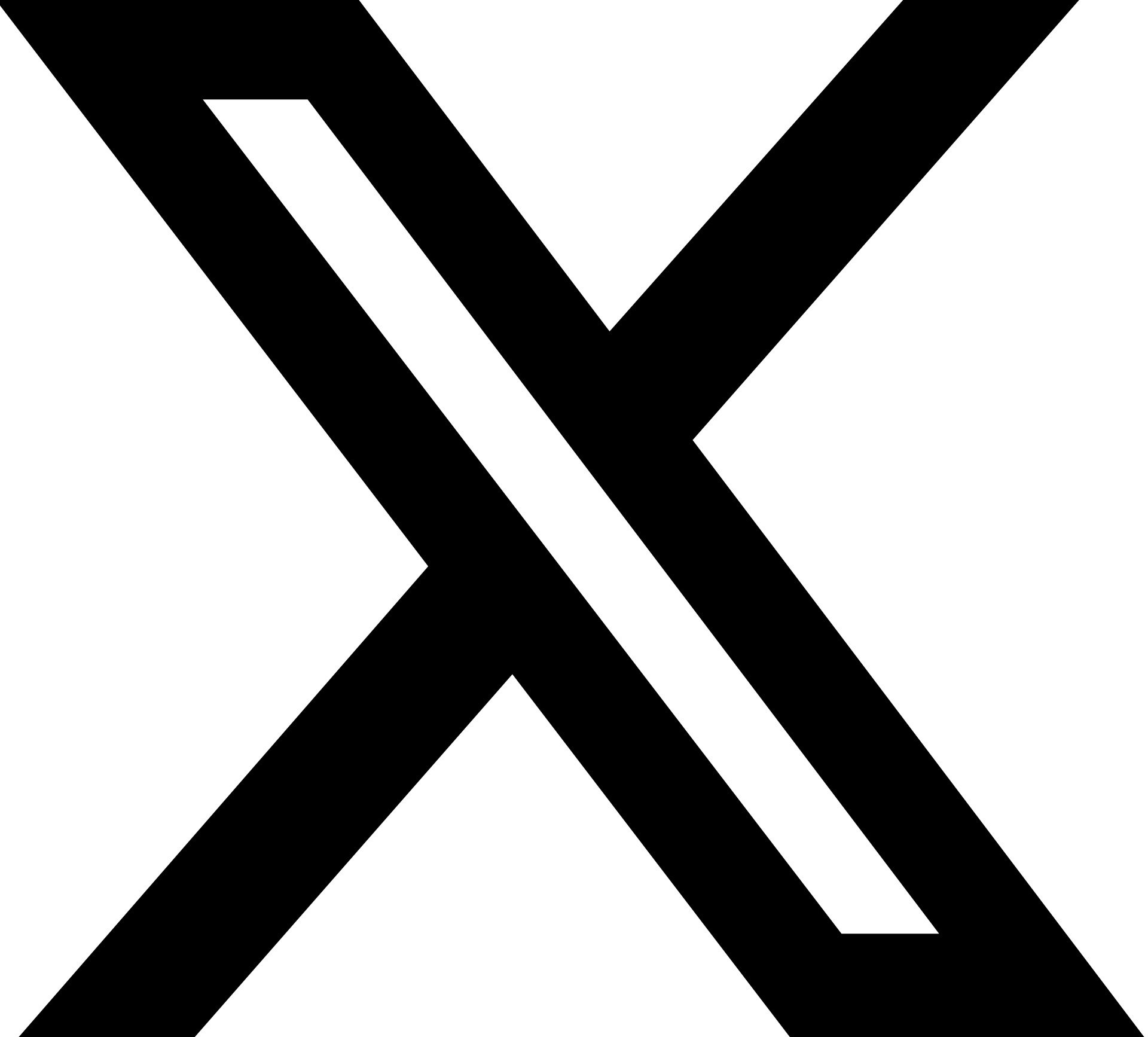Juste France

Le titre de « Justes parmi les nations », créé en 1953, n’avait pas été considéré jusque-là comme une source d’information pertinente sur la persécution des Juifs. Avec des approches différentes mais complémentaires, une sociologue et un historien ont étudié les Justes de France, leurs actes de sauvetage et leur place dans la mémoire.
Les « Justes » – ces non-Juifs qui ont sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale – représentent une catégorie mémorielle que nul, dans un public cultivé, ne saurait aujourd’hui ignorer. Ils n’ont pas toujours bénéficié de la même visibilité, bien que le titre de « Juste parmi les nations » ait été institué quelques années seulement après la Libération, par la loi de 1953 qui, en Israël, a créé l’institution nationale de commémoration de la Shoah et de l’héroïsme juif, Yad Vashem.
Au 1er janvier 2011, 3 376 titres avaient été décernés par l’institution (donc par l’État d’Israël) à des Français ou à des étrangers ayant agi en France. Cela représente 14% des titres accordés, la France se situant ainsi en troisième position, derrière la Pologne et les Pays-Bas. Si les critères de distinction sont précis (ne pas être juif, ne pas avoir agi pour l’argent, la demande doit venir des personnes sauvées, etc.), si la procédure est lourde (car reposant sur le mode de l’investigation criminelle), les historiens ont longtemps considéré que ce titre n’indiquait rien ni sur l’histoire de la persécution des Juifs, ni sur la mémoire du crime. Ce défi est relevé par deux chercheurs, dont l’approche diffère, mais qui finalement convergent. Travaillant en partie sur les mêmes archives (les dossiers de Justes de Yad Vashem ouverts aux historiens), ils montrent l’émergence de cette mémoire et l’utilisation que l’on peut faire des dossiers. Preuve de cette convergence, les deux auteurs affichent sur la couverture de leur livre une image identique, celle de la plaque apposée au Panthéon, où sont entrés symboliquement l’ensemble des Justes de France le 18 janvier 2007.
Demandes de mémoire
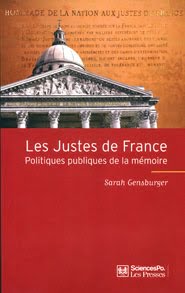
Le dense petit livre de Sarah Gensburger, tiré d’une thèse en sociologie soutenue à l’EHESS, interroge la catégorie des Justes de France comme résultat de « politiques publiques de la mémoire ». Dans des analyses fines et souvent techniques, elle montre comment la nationalisation (c’est-à-dire le processus qui a vu l’État français reconnaître et célébrer les récipiendaires français d’un titre étranger), certes tardive a été le résultat d’un jeu compliqué entre représentants de l’État (Jacques Chirac a joué un rôle moteur), quelques députés et quelques Juifs ayant survécu grâce à l’action de Justes. Ces derniers ont joué un rôle de passeurs entre Israël et la France : franco-israélien, actifs dans les cercles communautaires en France et dans les milieux francophones en Israël, ils ont tenté ce qu’on pourrait presque nommer une diplomatie culturelle parallèle, afin de rapprocher les deux pays : montrer les Justes de France en Israël, c’était apporter au public israélien une vision positive de la France – alors que les relations diplomatiques sont soumises à des aléas constants –, voir se multiplier les titres de Justes en France, c’était donner une vision plus positive d’Israël pour un public français. Symbole de cela, la création d’un Comité français pour Yad Vashem, antenne parisienne de l’institution autorisée à recevoir les dossiers de candidature pour titre de Juste. Ces passeurs franco-israéliens, accompagnés des membres du Comité, ont construit une « offre de mémoire » qui a été reprise par les élus, dans un contexte international favorable. L’émergence du statut de la victime, la fin de la prééminence d’une commémoration militaire de la guerre et de la Résistance, ont influé sur l’évolution des normes qui déterminent les catégories mémorielles : ce n’est plus le héros qui est mis en avant, le résistant, mais bien le simple civil qui a survécu, le survivant à la Shoah étant le plus symbolique. Le civil compassionnel, celui qui a aidé à sauver une vie dans un contexte non-militaire, est devenu le véritable porteur de l’attention mémorielle.
Sarah Gensburger montre finement comment, de balbutiante, cette mémoire des Justes, dont les fondements peuvent se dessiner d’ailleurs juste après la guerre, est montée en puissance à partir des années 1980, comme une réponse aux obsessions de la Shoah dans la société française. En bref, une offre mémorielle a été proposée à travers quelques passeurs, dont la position marginale dans la communauté juive est soulignée par l’auteur, et l’écho favorable reçu a amené les pouvoirs publics à se saisir de cette demande. Il est vrai que l’État français, la République française, était de plus en plus mise en accusation et que le tournant du discours de Jacques Chirac au Vel’ d’Hiv en juillet 1995 – avec la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la Shoah – a nécessité un contrepoids. L’État français est allé jusqu’à prévoir la création d’un titre de Juste purement français, un diplôme national qui répéterait ou ferait pendant au diplôme israélien. Gensburger est très convaincante dans l’analyse de l’émergence de ces « politiques publiques », grâce à l’identification des nombreux acteurs. Le titre français ne fut jamais créé mais l’État, sous l’impulsion première de Jacques Chirac, commença à célébrer les Justes de France. L’apogée fut la cérémonie au Panthéon, où les Justes de France furent accueillis collectivement et symboliquement, le 18 janvier 2007. Une exposition fut organisée dans le Panthéon pour permettre aux Parisiens de constater par eux-mêmes cette réalisation mémorielle. Une plaque a pérennisé cela.
« Les demandes adressées à l’État en matière de mémoire ne traduisent pas forcément une atomisation « communautaire », un éclatement « identitaire » et une mobilisation d’acteurs « concurrents » », observe la jeune sociologue : « Elles peuvent être au contraire l’expression, de la part d’acteurs sociaux jusqu’ici restés silencieux dans l’arène publique, d’une identification certes partielle et polysémique, aux institutions qui structurent dans la durée la politique de la mémoire de l’État » (p. 116-117). Elle montre aussi comment les Justes de France en sont venus à représenter, dans les discours publics, l’ensemble de la population française, contrebalançant le rôle de l’État et de l’administration française dans la perpétration du génocide.
Des réseaux organisés et informels
On peut aussi analyser la catégorie de « Juste » en l’inscrivant dans l’histoire de la Résistance civile, telle qu’elle a été définie il y a quinze ans par Jacques Sémelin [1]. La question de l’appartenance des Justes à l’ensemble de la Résistance a été posée à nouveau dans un volume collectif sur le sauvetage en situation génocidaire, La Résistance aux génocides. De la pluralité des actes de sauvetage [2]. Jacques Sémelin, qui n’a cessé d’affiner la définition de ce concept, a écrit qu’il s’agit d’un « processus spontané de lutte de la société civile par des moyens non armés, soit à travers la mobilisation de ces principales institutions, soit à travers la mobilisation de ses populations, ou bien grâce à l’action des deux à la fois » [3].
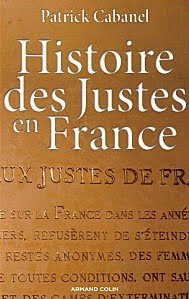
Une telle interrogation n’est pourtant pas centrale dans le livre de Patrick Cabanel, historien du protestantisme et du judaïsme français, les régions protestantes ayant souvent été des terres de sauvetage. Patrick Cabanel a écrit la première histoire complète des Justes de France. Ayant publié les émouvantes lettres écrites à Alice Ferrières, une Juste qui a placé des enfants dans des familles d’Auvergne [4], mais également des documents sur le « refuge » en Cévennes [5], l’historien a travaillé sur les dossiers de demande de médailles conservés à Yad Vashem, ainsi que sur la floraison de travaux, monographies, études régionales, études biographiques qui ont été publiés au cours des dix dernières années. Résultats de la constitution des Justes de France en catégorie mémorielle, reflets d’une demande d’explication et de commémorations, ces travaux très divers permettent d’appréhender la diversité des situations de sauvetage.
Patrick Cabanel contredit en partie l’image du Juste isolé qui, dans un mouvement spontané, cache une famille juive. Pour construire différentes catégories de Justes, il met l’accent sur des réseaux organisés ou informels, ce qui lui permet de dresser des tableaux saisissants de Justes liés entre eux. Ainsi, pour conclure un chapitre particulièrement intéressant sur les « terres, cités, frontières de refuge », l’historien offre un tableau des Justes de la frontière suisse, d’Annecy au lac Léman (p. 234). Quarante Justes y sont répertoriés. La frontière d’Annemasse et Douvaine, facilement franchissable, a attiré des milliers de persécutés. Mais, écrit l’auteur, « elle est devenue l’une des plus surveillées et dangereuses, et plusieurs drames l’ont endeuillée ». Des passeurs ont été arrêtés, torturés, déportés.
Car aider des Juifs présentait des dangers évidents. La situation était cependant différente de celle qui régnait en Europe centrale et orientale : là-bas, un passeur ou un sauveteur était immédiatement fusillé avec les Juifs qu’il avait pris en charge. En France, le risque était moindre mais, précise Cabanel, cela constitue un savoir a posteriori, que ne possédaient pas les sauveteurs. Il y a eu par ailleurs quelques cas de Justes assassinés uniquement parce qu’ils avaient aidé des Juifs – et non pour des activités de résistance politique ou armée.
Sociologie et géographie des Justes
Les données recueillies par Patrick Cabanel lui permettent de dresser des tableaux sur la sociologie des Justes. Ils provenaient de toutes les catégories sociales, des plus élevées – il y eut même un ministre, Paul Ramadier – aux plus humbles. Nombreuses ont été les femmes de milieu modeste qui ont apporté leur aide, parce qu’elles avaient été mises en contact par leur métier avec les familles et surtout avec les enfants : infirmières, concierges, bonnes d’enfants, institutrices, celles qui offrent ce qu’on appelle aujourd’hui « des services et des soins à la personne » (p. 83). Treize châtelains sont devenus des Justes ; le fait qu’ils avaient de la place pour cacher des fugitifs a pu jouer un rôle. Les ouvriers sont sous-représentés, peut-être parce que les sauvetages se sont déroulés loin des grandes concentrations industrielles du nord et de l’est de la France.
De façon intéressante, l’auteur analyse la géographie du sauvetage en comparant le nombre de Justes par département. Ils ont été nombreux dans les terres de refuge (montagnes), mais aussi dans les couloirs qui descendent de la région parisienne vers la zone Sud. La région la plus connue pour avoir accueilli des Juifs, celle qui a vu le plus de Justes nommés, est bien sûr les Cévennes. Mais d’autres départements, au regard des statistiques produites, ont aussi vu de larges concentrations de simples civils prenant des risques pour aider et cacher les proscrits de Vichy et du nazisme. Il est en ainsi par exemple de la Drôme.
Cabanel classifie également les Justes, décrivant les « diplomates de la défaite » qui ont fourni des visas (la figure majeure est celle d’Aristide de Sousa Mendes, consul général du Portugal à Bordeaux), ceux qui ont travaillé dans et autour des camps d’internement pour Juifs étrangers, ceux qui vivaient dans des terres de refuge et de frontières et, finalement, ceux qui ont aidé les enfants – convoyeuses, responsables d’écoles laïques ou chrétiennes, réseaux congrégationistes et même pédagogues d’avant-garde.
Quelles motivations ?
Le livre de Cabanel apporte des réponses, mais il laisse quelques questions ouvertes, par exemple au sujet des motivations des sauveteurs. Peu étaient engagés politiquement avant la guerre. Faut-il en revenir à des explications psychologisantes, comme celles développées au États-Unis sur la « personnalité altruiste » ? Elles sont peu opératoires. Il serait intéressant de tenter de quantifier le nombre de Français qui ont aidé des Juifs, par des gestes fugitifs, des gestes non reconnus.
Par ailleurs, le point aveugle de ces recherches sur les Justes de France est de placer le balancier un peu trop vers le « bien » et d’oublier l’indifférence, mais aussi la collaboration passive et active à la persécution, notamment les dénonciations. On pourrait aussi reconsidérer les liens des sauveteurs avec la Résistance organisée. À lire les multiples exemples décrits par Cabanel, on se demande s’il n’y a pas là un aspect essentiel : beaucoup de Justes ont été en contact avec des réseaux, pour obtenir des faux papiers, organiser un transport, trouver une filière de passeurs, etc. Enfin, les liens d’avant-guerre entre persécutés et sauveteurs mériteraient d’être creusés [6].
Sarah Gensburger et Patrick Cabanel interrogent très justement le silence de l’après-guerre. Il semble qu’après 1945, et mis à part la reconnaissance souvent tardive par Yad Vashem puis par l’État français, rien ne se soit passé. Or les liens tissés entre les persécutés et les Justes devraient être décrits, ne serait-ce que pour mieux comprendre la révolution qu’a constitué le dialogue judéo-chrétien. Il est notable que Cabanel propose une justification morale de son travail : « Nous devons apprendre à écrire l’histoire en sortant du huis clos des bourreaux et des victimes et en abordant un tiers parti généralement très majoritaire », conclut l’auteur. « Les gestes qu’ils [les Justes] ont fait en faveur des Juifs, les signes qu’ils leur ont envoyés, les mots qu’ils ont dits […], nous en sommes aussi les destinataires, et, par-delà le temps, le fracas de la violence, le silence de l’oubli, c’est à nous qu’ils parviennent, pour nous apporter un peu d’apaisement et le renouement d’un lien essentiel » (p. 391).
Jean-Marc Dreyfus
Notes
source: http://alsace.france3.fr/2013/01/28/les-justes-parmi-les-nations-au-lycee-ort-de-strasbourg-189267.html du 25/01/2103