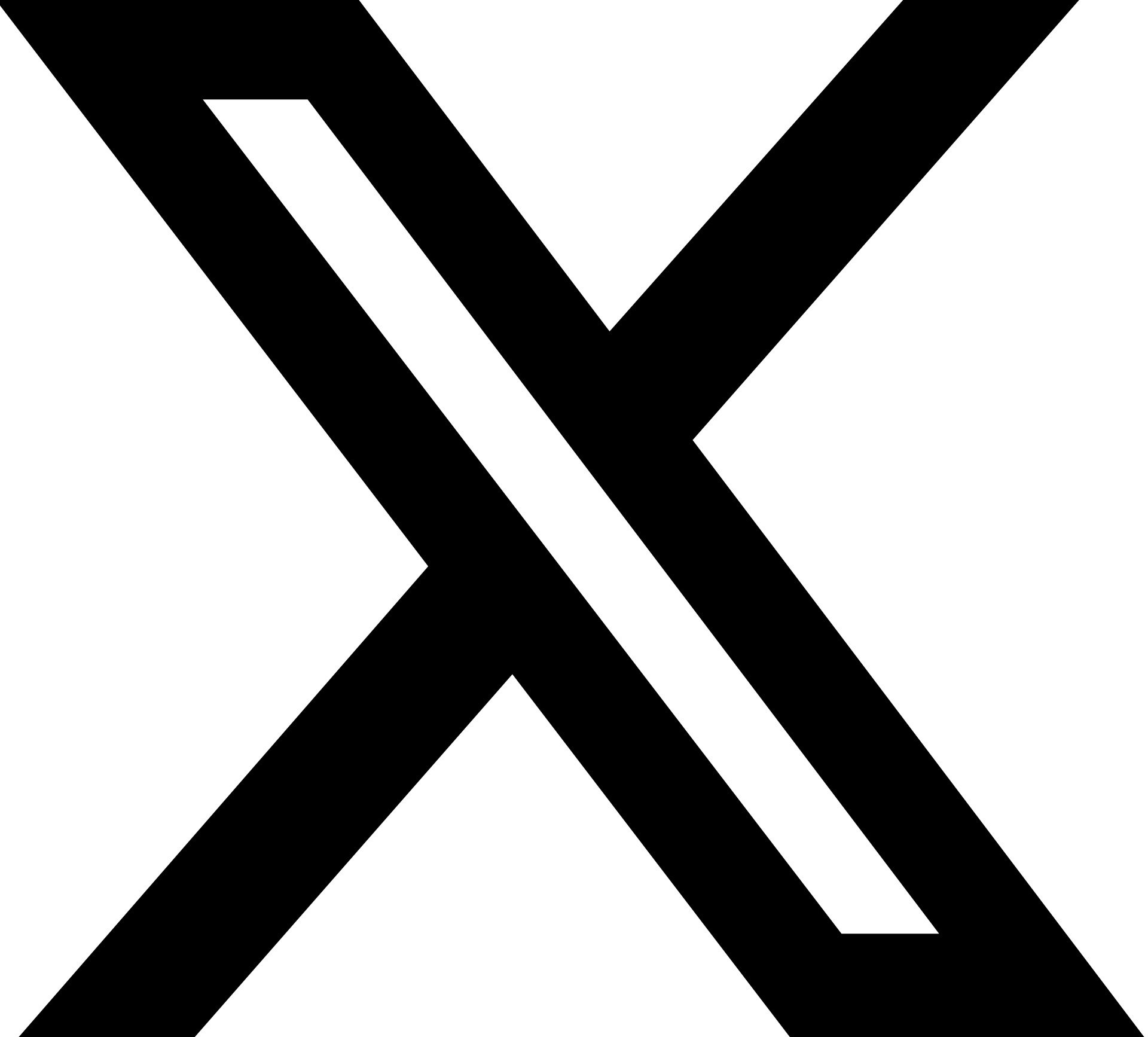Publié dans le Figaro.
TRIBUNE – Des mains rouges ont été peintes sur le mur des Justes du Mémorial de la Shoah dans la nuit du 13 au 14 mai. Un acte ignoble qui souille la mémoire de ceux qui sauvèrent des Juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale, s’indigne l’écrivain, lui-même petit-fils de Justes.

Camille Pascal. Fabien Clairefond
Dans la nuit du 13 au 14 mai, le mur des Justes, qui conserve, à Paris, les noms de ces Français qui ont sauvé l’honneur de notre pays et l’esprit d’humanité en sauvant des dizaines de milliers de Juifs pourchassés par la milice et l’occupant a été vandalisé. Des mains rouges, qui se veulent sanglantes, sont venues maculer le marbre noir du souvenir dans les replis pourtant bien discrets du Mémorial de la Shoah, dans le quartier du Marais.
Ces mains seraient là, me dit-on, pour rappeler le drame que vivent les populations parquées à Gaza. Est-ce à dire que, en sauvant des Juifs il y a plus de quatre-vingts ans, les Justes de France auraient une responsabilité quelconque dans le conflit israélo-palestinien ? Je n’ose même pas développer ce syllogisme historique, car il pourrait alors trop clairement laisser entendre que, sans les rescapés de la solution finale, il n’y aurait pas aujourd’hui un État juif en Palestine…
Personne ne peut accepter le cynisme de ce message implicite sans réagir, mais il se trouve par ailleurs que je suis moi-même petit-fils de Justes, Georges et Lucie Pascal, et qu’au-delà des sous-entendus abjects charriés par ce vandalisme ciblé il y va de la mémoire de mes grands-parents paternels et du nom que je porte. Jamais je n’ai cherché à tirer une gloire personnelle d’un héroïsme qui n’était pas le mien, car, pour reprendre la belle expression de Jean Delay, il appartient à mon avant-mémoire et j’hésite toujours à en faire publiquement état.
Une raison simple à cela, je ne sais pas si j’aurais eu ce courage de cacher des Juifs sous mon toit pendant toute l’Occupation et d’assurer ainsi leur sécurité aux dépens de celle de ma propre famille. Car c’est bien de cela qu’il s’agit, et le témoignage de Gustav Nussbaum, recueilli par l’Institut Yad Vashem, est formel. Dès le 10 mai 1940 et l’invasion du Luxembourg par l’Allemagne, les époux Nussbaum et leur fils Gustav, alors âgé de 6 ans fuient vers la France. Après un voyage rocambolesque sur les chemins de l’exode, ils arrivent à Ganges, petite ville aux portes des Cévennes, cachés dans des corbeilles à pain. Ils sont alors recueillis par ma grand-mère qui se charge de leur fabriquer des faux papiers et de les loger au « maset » familial perdu dans les oliviers. Ils y resteront jusqu’à la Libération, protégés par le maquis que mon grand-père a rejoint dès novembre 1942 et, ne l’oublions pas, grâce à la complicité de toute une population.
Ces Justes qui n’ont jamais rien demandé de leur vivant, ni remerciements, ni honneur, ni considération particulière, se voient aujourd’hui insultés à titre posthume.
Pendant ces quatre ans, Gustav, qui ne parlait pas un mot de français à son arrivée, va aller à l’école et nouer avec mon oncle et mon père, qui ont à peu près son âge, une amitié de galopins. Ce sera « la guerre des boutons » en pleine Seconde Guerre mondiale. Un jour, les trois garçons subtilisent le film des actualités Pathé pour en découper avec soin toutes les images où l’on voit le maréchal Pétain. Alertée par le projectionniste, ma grand-mère passera une nuit blanche à recoller ces images d’une propagande qu’elle exècre pour éviter une descente de police. En bonne catholique, elle n’oublie pourtant pas de donner à Gustav des rudiments de catéchisme, de lui offrir des jouets à Noël et du chocolat à Pâques. Du chocolat… en plein rationnement ! Cinquante ans plus tard, le témoin n’a pas oublié le souvenir de ces quelques carrés de chocolat.
Jamais les Nussbaum ne manqueront de quoi que ce soit, jamais personne ne les dénoncera, jamais ils ne seront arrêtés, jamais ils ne seront déportés, jamais ils ne passeront trois jours et trois nuits dans un wagon à bestiaux pour être débarqués dans « la nuit et le brouillard » sur le quai de la gare d’Auschwitz-Birkenau. Jamais la famille Nussbaum ne sera séparée après le tri, jamais ils ne seront comptés à l’appel comme de vulgaires Stücke (« morceaux » en allemands), jamais le petit Gustav n’aura à se serrer nu contre sa mère dans une chambre à gaz…
Les Nussbaum ont survécu. Voilà ce que l’on semble aujourd’hui reprocher implicitement à mes grands-parents, comme aux trois mille neuf cents héros anonymes dont le souvenir est gravé dans le même marbre. Eux qui n’ont jamais rien demandé de leur vivant, ni remerciements, ni honneur, ni considération particulière, se voient aujourd’hui insultés à titre posthume.
Voilà le visage de la France qu’une poignée de militants déculturés par une autre propagande vient de gifler. Jamais le rouge de la honte n’a été plus vif que sur ce mur.